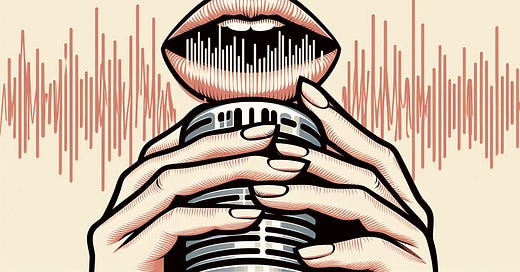Le journalisme et l’opinion affichée
De plus en plus de journalistes indépendants affichent leurs opinions de manière franche et transparente. Mais ce n’est pas pour tout le monde…
Je suis fasciné par la nouvelle batch de journalistes qu’on voit ces temps-ci. Ceux qui cassent les codes du journalisme et sautent à pieds joints dans l’influento-sphère. Ils demeurent journalistes et rapportent la nouvelle… tout en affichant leur personnalité, leurs passions et – le plus gros interdit de tous dans notre métier – leurs opinions.
J’ai déjà parlé de Rachel Gilmore, qui a récemment vécu un certain rollercoaster à cause de sa façon de faire du journalisme (je vous invite à aller voir son compte TikTok pour savoir ce qui s’est passé). Vous avez sûrement aussi vu les vidéos de Isaac Peltz. J’ai un intérêt sans fond pour leur contenu et leur façon de redéfinir les codes du métier.
Vous allez me dire que moi aussi je donne mes opinions, et c’est vrai. Mais moi je ne suis plus vraiment le dude qui rapporte la nouvelle à l’hôtel de ville. Je suis plus l’expert auto-proclamé qui déblatère de ses idées assis en bobettes sur le divan.
Ceci dit, j’ai quand même parlé à d’autres personnes qui ont ce genre de réflexion. Pants on, je vous le jure.
Un espace à investir
Une chose qui est claire, c’est qu’il y a au moins une demande minimale pour du monde qui rapportent et/ou expliquent la nouvelle en affichant clairement leurs positions. Que ce soit un ingénieur-avocat-économiste qui fait ça dans ses temps libres parce qu’il est pas déjà assez hot de même (looking at you Farnell Morisset) ou que ça soit quelqu’un qui s’est cassé le nez pendant des années dans des hebdos en région pour apprendre comment coincer un politicien sans se sentir petit dans ses shorts… on s’en câlisse un peu.
Dit autrement : si c’est pas nous qui le faisons, ça sera quelqu’un d’autre. Et le public s’en fiche.
« Je pense qu’on ne peut pas l’éviter », me dit Gabrielle Brassard-Lecours, cofondatrice de Pivot. « Les jeunes, ils ne sont plus sur nos sites web alors il faut aller les rejoindre sur les réseaux sociaux. »
« Moi quand je vais sur TikTok et je vois genre une Nancy qui me dit "L’affaire Northvolt, je vous explique tout", je me dis t’es qui toi pour m’expliquer tout? C’est quoi ton street cred? Nous les journalistes, peut-être qu’il faut qu’on investisse cet espace, parce qu’au moins nous on est des experts. »
Alors on investit ça avec de l’analyse, ou avec de l’opinion aussi?
« Je ne suis pas sûre que je prendrais position autant sur les réseaux sociaux », relativise Gabrielle, qui travaille en étroite collaboration avec Isaac Peltz. « De toute façon, j’ai quand même créé un média de gauche, alors c’est assez clair où je campe! »
Un autre privilège blanc?
J’ai aussi parlé à Lela Savic, fondatrice de La Converse. Et elle m’a fait remarquer quelque chose qui m’avait complètement échappé.
« Les personnes qui peuvent se permettre de faire du commentariat, ce sont majoritairement des personnes blanches », dit-elle.
Ouin… même en transcrivant ces paroles-là, je me rends compte que tous ceux que j’ai name-droppé jusqu’à présent sont blancs. Et selon Lela, qui est rom, il y a une raison pour ça.
« Étant une femme racisée, juste en existant dans l’espace médiatique on te traite de militante si tu touches des enjeux raciaux. Alors si tu commences à faire du commentariat en plus, ma crainte c’est que tu vas être complètement décrédibilisée. »
Tranche de vie : Lela était mon employée chez Métro et, oui, dès qu’une partie du lectorat apprenait qu’elle avait des origines autres, les commentaires sortaient quand elle publiait un article touchant la diversité. Même La Presse l’a qualifiée de « journaliste et militante » quand elle a été invitée à expliquer la controverse autour du film Jouliks, alors qu’elle n’est membre d’aucun organisme et ne milite pour aucune cause.
Un peu plus tard, le Québec au complet s’est indigné quand SNL a osé rire de nos baguels. Y compris des journalistes, qui n’ont pourtant jamais été qualifiés de « militants ».
Donc ouin… peut-être que c’est pas donné à tout le monde d’afficher ses opinions de même.
(Il faut quand même souligner qu’il y a bel et bien des personnes racisées qui s’expriment haut et fort sur diverses tribunes, comme Vanessa Destiné.)
Le marché et la chambre d’écho
Lela souligne aussi qu’en s’affichant trop ouvertement, on éloigne une partie de notre auditoire potentiel et on participe ainsi au phénomène des chambres d’écho.
« Je trouve qu’il y a trop de chroniques au Québec quand on parle d’enjeux raciaux, que ça vienne de la droite ou de la gauche. On n’a pas de chroniques à La Converse et je trouve que c’est important pour préserver ce qu’on appelle le journalisme de dialogue. Être donneur de leçon, ça ne fonctionne pas. On finit par prêcher aux convertis. »
Patrick White, professeur et ex-rédacteur en chef du HuffPost Québec, est du même avis. « Il ne faut pas chercher la controverse pour la controverse. On n’a pas besoin de ce genre de clivage. »
Patrick souligne les réussites d’initiatives comme Rad et Les As de l’info, ou encore le travail de Hugo Meunier chez Urbania. Il aimerait voir un « Hugo Décrypte du Québec ».
So, qu’est-ce qu’on fait avec ça? C’est vrai, c’est clivant. Ça participe à la polarisation grandissante de la société. Mais en même temps… so what? C’est pas les médias qui ont créé le phénomène de la polarisation, c’est tout simplement la dynamique du web alors que les plateformes d’échange sont très peu réglementées. Alors on ne règle pas le problème en l’évitant. On manque tout simplement le bateau.
Il y a un marché pour l’information incarnée, avec des opinions transparentes. Et puis, Rachel et Isaac font quelque chose que les autres ne font pas : ils rapportent la nouvelle en même temps qu’ils la commentent. Hugo Décrypte, c’est l’analyse après-coup des nouvelles qui sont sorties ailleurs. Isaac, lui, produit des enquêtes sur le logement et sur le NPD. Rachel rapporte quotidiennement les informations qui sortent de la campagne électorale, tout comme n’importe-quel autre journaliste.
Ceci étant dit, il y a un marché encore beaucoup plus gros pour de l’information un peu plus neutre. Ça peut être super incarné, comme Milik Bélanger-Sévigny sur Noovo ou Julia Pagé de Rad. Mais il y a une ligne qui n’est pas franchie : celle de l’opinion.
Isaac et Rachel peuvent très bien tirer leur épingle du jeu avec une carrière bâtie autour de leur personnalité. Mais pour la plupart des médias établis, c’est pas nécessairement l’option à suivre. Surtout dans les médias locaux, qui demeurent mon principal focus : il y a déjà assez de gens qui donnent leurs opinions sur les nids-de-poule!
Au final, je vois ça comme un espace à investir, comme tous les autres. Une partie du marché veut de l’information bien campée dans des positions claires, alors fournissons cette information avant que quelqu’un d’autre ne le fasse! Et, pour le reste du marché, on continue avec une approche plus traditionnelle.
Bien entendu, si tu veux savoir si c’est une approche qui te convient comme média ou comme journaliste, tu viens me voir et on se fait un petit plan de match.